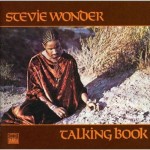Tout le monde connait son nom, beaucoup moins sa musique. Et pourtant, Stevland Hardaway Judkins -de son nom de naissance- est aujourd’hui l’artiste le plus repris et le plus samplé au monde, loin devant les Beattles, Bob Dylan, et autres références musicales de l’ère moderne (comprendre : depuis qu’on fait autre chose que du claveçin dans les églises…). Multi-instrumentiste aveugle et surdoué, Stevie Wonder est aussi le musicien le plus récompensé, cumulant Grammy Awards et une trentaine de hits classés en cinq décennies.
Mais cette réalité ne témoigne même pas encore suffisamment de l’impact que la musique de Stevie Wonder a eu, et a toujours, sur l’ensemble du spectre musical, et pas seulement des genres déscendants de la musique noire américaine du siècle dernier, si éloignés soient-ils. Car dans tous les registres et à tous les étages, on retrouve des artistes qui se sont inspiré, voir même qui ont carrément ré-arrangé les titres d’un des derniers monuments de la soul. Pour rappel, à part Al Green et George Benson, toutes les icônes de l’époque bénie de la soul nous ont quitté. Pour ne citer qu’eux : Ray Charles, James Brown, Barry White, Ottis Redding, Isaac Hayes, Marvin Gaye et plus récemment le grand Michael Jackson… Histoire d’une légende (encore) vivante…
1961-1970 : les débuts
Très rapidement attiré par la musique (dans son cas, plus accessible que le tir à l’arc vous vous en doutez), il maitrise trois instruments dès son plus jeune âge pour animer des offices religieux : harmonica, tambour et piano. A 10ans, il intègre le label Tamla Motown (qui deviendra Motown en 1975) grâce au cousin de Smokey Robinson, et est baptisé « Little Stevie ». Si les premiers titres du prodige, « Mother Thank You » et « I Call it Pretty Music », en 1962, ne parviennent pas à s’imposer, l’album consacré au répertoire de son idole (Tribute to Uncle Ray) le fait connaître, ainsi que The Jazz Soul of Stevie Wonder l’année suivante. C’est sur scène que ses dons éclatent au grand jour. En témoigne l’album Recorded Live – The 12 Year Old Genius, dont est extrait « Fingertips (Pt. 2) », n°1 des classements pop à l’été 1963.
En 1964 sort l’album With A Song In My Heart et quelques chansons sans conséquence. Une tournée en première partie des Rolling Stones peine à convaincre Berry Gordy (Patron de Tamla Records) de garder le poulain qui ne réédite guère son exploit, et auquel on a retiré le surnom de « Little ». Seulement, début 1966 arrive le hit « Up-Tight (Everything’s Alright) » (n°3), puis « Nothing’s Too Good for My Baby » et « A Place in the Sun ». « I Was Made to Love Her », n°2 à l’été 1967, établit sa notoriété en Europe après une tournée.
Suivent « I’m Wondering » et « Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day » en 1968, et le curieux album Eivets Rednow (anagramme de Stevie Wonder) dont les compositions étaient destinées à être jouées par le guitariste Wes Montgomery disparu prématurément. La compilation Stevie Wonder’s Greatest Hits, est suivie d’une nouvelle salve de hits : « For Once in My Life » (n°2), « Yester-Me, Yester-You, Yesterday » et « My Cherie Amour ».
Il commence à assurer lui-même le rôle de producteur sur l’album Signed, Sealed and Delivered sorti en 1970. À sa majorité en 1971, il entre en conflit avec son label, suite à la découverte des sommes versées sur son compte (30 millions de dollars pour Motown, 1 million pour lui…), et obtient une complète liberté artistique. La carrière de Stevie peut commencer…
1970 – 1978 : les classiques
La période que je préfère d’un point de vue musical. Désormais maître de ses productions, Stevie est allé au bout de son génie pour nous pondre les meilleurs albums de sa carrière. Moins formaté, Signed, Sealed and Delivered (1970) est un début timide mais réussi dans le genre.
En 1971, Where I’m Coming From est la preuve de cette liberté : un album intime et planant, qui demeurre pour moi un album référence tant il a donné le ton aux albums qui suivront. Music of My Mind (1972), disque fusionnant la soul, le jazz et le rock, et les synthétiseurs à la pointe de la nouveauté, en est le parfait exemple. C’est grâce à cet album que la carrière de Stevie Wonder va exploser.
Avec ses musiciens et choristes de Wonderlove, il part en tournée. Stevie Wonder souhaite toucher le public rock en choisissant de se produire avant The Rolling Stones. A la fin de l’année sort « Superstition » (n°1), qui invite le guitariste Jeff Beck. La ballade « You Are the Sunshine of My Life » se hisse également au sommet. Entre temps, l’album Talking Book confirme le virage électronique de Wonder (« Blame It On The Sun », mais aussi ma love song préférée « You and I »). Il inaugure la série de chefs-d’œuvre des années à venir : Innervisions en août 1973, comprend « Higher Ground », « Don’t You Worry ‘Bout a Thing » et « Living for the City », ouvertement politique. Il lui rapportera six Grammy Awards.
Revenu en studio, il livre Fullfillingness First Finale (1974), album introspectif et mystique (avec néanmoins deux hits, le n°1 « You Haven’t Done Nothing » et « Boogie on Reggae Woman »).
Il s’ensuit un long silence d’un an et demi pendant lequel il compose et peaufine les détails d’un album très attendu. Wonder en profite pour renégocier son contrat avec Tamla Motown, obtenant 13 millions de dollars qu’il réinvestit en studio, station de radio et dons aux oeuvres caritatives.
En septembre 1976 paraît enfin Songs in the Key of Life, un plantureux double album d’une diversité étonnante et d’un potentiel de hits qui en font l’un des disques majeurs de la décennie : « I Wish » et « Sir Duke » et « Isn’t She Lovely » montent au sommet des classements. Il est couronné par quatre Grammy Awards.
1979 – 1991 : la période commerciale
Après cette oeuvre-maîtresse, Stevie Wonder travaille désormais sans pression, à un rythme toujours plus lent. C’est dans la plus grande discrétion qu’il effectue son retour avec le double et expérimental Journey Through the Secret Life of Plants (1979). Il réapparaît à l’automne 1980 avec le plus conventionnel, quoique extrêmement bien réussi Hotter Than July, aux mélodies enivrantes : « Masterblaster » (hommage parfait à Bob Marley mort la même année), « All I do », l’inusable « Happy Birthday » et un superbe « Lately » (la reprise lors d’un live de Jodeci est d’ailleurs pas trop mal réussie).
En mars 1982, le chanteur fait un duo avec Paul McCartney sur « Ebony and Ivory » (n°1). Cette même année, la compilation Original Musicquarium I offre quatre titres inédits dont me sublime « Ribbon in the sky ». Parallèlement, Wonder produit d’autres artistes et collabore avec Elton John pour le tube « I Guess That’s Why They Call it the Blues » en 1984 (n°1 et un Oscar), extrait de la bande originale du film The Woman in Red, partagée avec Dionne Warwick. Ils se retrouvent pour « That’s What Friend Are for » (n°1).
L’année 1985 est marquée par sa participation au projet USA for Africa et son titre co-écrit avec Michael Jackson et Lionel Richie « We are the world » et le concert du Band Aid à Philadelphie . Un nouvel album, In Square Circle offre le n°1 « Part-Time Lover ». Cependant, il semble mettre de côté les expérimentations passées au profit d’un style immédiatement reconnaissable. Il en va ainsi de l’album Characters (1987, avec « Skeletons »), de ses collaborations avec Julio Iglesias (« My Love ») ou Michael Jackson (« Get it ») en 1988.
L’année suivante, il célèbre la libération de Nelson Mandela dans le symbolique « Free », et effectue son entrée au Rock and Roll Hall of Fame. La bande originale du film Jungle Fever (1991), film réalisé par Spike Lee, est l’occasion d’un léger regain de créativité.
1992 – 2011 : La pénurie d’albums
En 1995 sort le plus commun Conversation Peace, porté par le hit « For Your Love », suivi d’une tournée qui débouche sur le live Natural Wonder. S’il demeure une personnalité médiatisée, Stevie Wonder se fait rare musicalement. Il faut attendre 2005 pour écouter A Time 2 Love (dernier album en date) et ses collaborations avec Prince (« So What the Fuss »), Carlos Santana, Paul McCartney et avec sa choriste de fille Aïsha Morris sur le jazzy « How will I know ».
L’actualité studio de Stevie plutôt pauvre depuis 20 ans, c’est ailleurs qu’il faut regarder pour se rendre compte de l’activité débordante du génie : des concerts partout dans le monde, un magnifique passage au Michael Jackson Memorial en 2010, et une plétore de duos plus ou moins réussis.
Pour être clair, l’apogée de sa carrière est derrière lui, mais force est de constater que chacune de ses apparitions, en studio ou sur scène, déplace encore et toujours les foules de tous horizons. Le nombre incalculable de reprise depuis les années 90 et la période New Jack a aussi permi, en quelque sorte, de garder Stevie sur le devant de la scène.
J’ai, pour ma part, eu la chance de le voir en concert à Paris en 2009, concert que même Bercy, pourtant réputé pour pourrir la musique d’un artiste de par la sonorité moisie de la salle, n’a pas réussi à gâcher tant la fête et l’émotion furent au rendez-vous.
Je vous l’avoue clairement, c’est Stevie qui a définitivement fait passé Queen en second dans mes artistes favoris. Sa musique me parle, me transporte, me motive, m’émeut, me fait sauter de joie, me fait pleurer, me fait courrir,… Bref il ne se passe pas un moment ou je n’ai pas un de ses airs dans un coin de ma tête. J’en profite pour faire une dédicace à Joss, my bro’, avec qui j’ai partagé mes plus beaux moments « post-adolescent » de musique. J’aurais déjà pu le mentionner lors de mon billet sur George Benson qu’il m’a fait découvert, mais ça me paraissait tellement mieux de le faire ici… Kiss frangin, et n’oublie pas : mauve=> banane et donc banane => mauve !!!
Les 5 albums à avoir absolument
Uptight (Motown/Universal)
Lorsqu’il signe Uptight en 1966, le « petit » Stevie Wonder n’a que 16 ans (!), mais sent bien confusément que sa carrière d’enfant prodige menée avec brio depuis déjà quatre longues années, touche à sa fin. C’est sans doute pourquoi cet album de transition apparaît avec le recul à la fois comme l’apogée de sa « première manière » et l’album où transparaissent les premières manifestations d’un talent singulier et parfaitement hors-norme. Sans rien révolutionner de façon fondamentale, le musicien s’émancipe avec finesse de l’influence du parrain de la soul, Ray Charles, et oriente son répertoire tant dans sa thématique (avec notamment la reprise de l’hymne contestataire de Dylan, Blowin’ the wind), que dans sa couleur générale, aux limites extrêmes des canons esthétiques du label Motown… L’apothéose d’un style et l’amorce subtile d’une première maturité…
Music of my mind (Motown/Universal)
Avec son titre-manifeste, Music of my mind est sans nul doute l’album de la rupture dans la carrière de Stevie Wonder, celui où, pour la première fois, le musicien prend résolument la parole et fait entendre la musique qu’il a réellement « en tête »…
Nous sommes en 1972, la musique noire est en pleine révolution sociale et esthétique : James Brown, Marvin Gaye, Isaac Hayes enregistrent chef-d’oeuvres sur chef-d’oeuvres – Wonder qui arrive à la fin de son contrat avec Motown le renégocie dans le sens d’une nouvelle autonomie créatrice. Il compose, produit, arrange la totalité des chansons du disque, s’enferme en studio pour jouer seul de la plupart des instruments et enregistre une oeuvre ambitieuse, pensée, construite, rompant définitivement cette fois avec la logique purement commerciale et le savoir-faire roublard qui présidaient jusqu’alors à la conception de ses disques. Une authentique déclaration d’indépendance.
Talking book (Motown/Universal)
Enregistré la même année que le programmatique Music of my mind, Talking book vient en quelque sorte, dans la foulée, réaliser somptueusement toutes les intuitions et promesses ébauchées quelques mois plus tôt. Fidèle à sa nouvelle méthode Wonder, en véritable démiurge, contrôle toutes les étapes de la conception et de la réalisation du disque, attentif aux moindres détails, perfectionniste jusqu’à la névrose.
Le résultat est à la mesure de l’engagement : une musique à la fois mature et spontanée, sensuelle et directe derrière la sophistication des arrangements, gorgée de mélodies exceptionnelles dont deux deviendront des hits interplanétaires : Superstition et You are the sunshine of my life… Le premier chef-d’oeuvre indiscutable de Stevie Wonder, annonciateur d’une longue série.
Innervisions (Motown/Universal)
A peine un an plus tard Stevie Wonder signe avec Innervisions son disque le plus directement engagé politiquement, mettant clairement son art au service du combat identitaire de la communauté noire américaine…
Un funk forcené, des arrangements raffinés et somptueusement minimalistes, des mélodies capiteuses et ensorcelantes, au service d’un discours utopique et militant, branché sur la réalité sociale. Stevie Wonder oublie là définitivement les sucreries futiles et rejoint le Marvin Gaye de What’s going on à l’avant-garde de la conscience afro-américaine. Un disque-phare de la musique populaire noire.
Songs in the key of life (Motown/Universal)
Il faudra trois longues années à Stevie Wonder pour concevoir et réaliser ce qui demeure à ce jour non seulement son plus grand disque mais l’un des quelques monuments incontournables de l’histoire de la musique noire, tous genres confondus. Plus le temps passe plus Songs in the key of life apparaît comme une somme indépassable, une oeuvre synthétique géniale d’une ambition démesurée brassant tous les styles (jazz, funk, pop, ballades soul) avec un bonheur expressif constant.
Chaque chanson est un hit potentiel (Sir Duke, I wish, Isn’t she lovely, As, Another star, etc.), la qualité des arrangements atteint des sommets de raffinement, sans qu’à aucun moment le projet d’ensemble ne se dilue dans les détails. Jamais depuis, malheureusement, Stevie Wonder n’a retrouvé un tel degré d’inspiration.